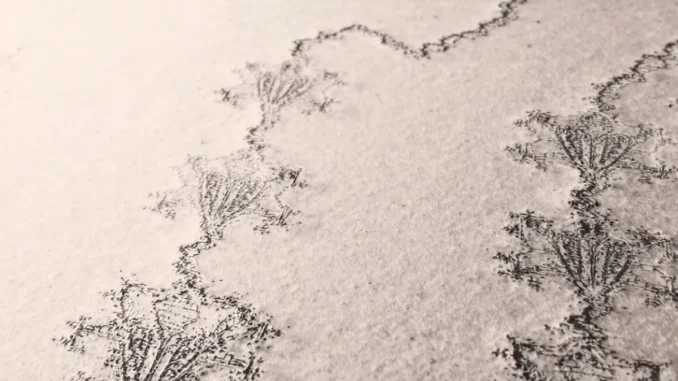
Face à l’augmentation des contentieux relatifs aux créances anciennes, la problématique de la preuve de l’ancienneté constitue un défi majeur pour les praticiens du droit. Lorsqu’un créancier tente de recouvrer une somme due depuis longtemps, il se heurte souvent à l’obstacle de la prescription et à la difficulté d’établir l’existence même de sa créance. Cette situation génère une insécurité juridique tant pour les créanciers que pour les débiteurs présumés. Les tribunaux français ont développé une jurisprudence riche mais complexe sur cette question, établissant un équilibre délicat entre protection du créancier et sécurité juridique. Examinons les mécanismes juridiques applicables, les stratégies de défense et les solutions envisageables face à une créance dont l’ancienneté n’est pas démontrée.
Le cadre juridique de la prescription des créances
La prescription extinctive constitue le premier rempart contre les créances anciennes. Ce mécanisme juridique fondamental vise à éteindre l’action en justice après l’écoulement d’un certain délai. Le Code civil a connu une réforme majeure avec la loi du 17 juin 2008, qui a profondément modifié le régime de la prescription. Le délai de droit commun est passé de trente à cinq ans, comme le prévoit l’article 2224 du Code civil qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Toutefois, des délais spécifiques existent selon la nature de la créance :
- Les créances entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans
- Les loyers, charges locatives et indemnités d’occupation se prescrivent par trois ans
- Les créances de salaires se prescrivent par trois ans
- Les créances relatives aux factures d’eau, d’électricité et de téléphone se prescrivent par deux ans
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 26 février 2020 (Civ. 1ère, n°18-25.036) que « la charge de la preuve de la date du point de départ de la prescription incombe à celui qui l’invoque ». Cette jurisprudence constante place le fardeau de la preuve sur celui qui se prévaut de la prescription, généralement le débiteur.
Le point de départ du délai de prescription constitue souvent le nœud du problème. Il s’agit théoriquement du moment où le créancier a connaissance de l’existence de sa créance et de l’identité du débiteur. La jurisprudence a progressivement affiné cette notion, notamment dans un arrêt du 4 mai 2017 (Civ. 2ème, n°16-17.133) où la Cour de cassation a jugé que « le point de départ du délai de prescription d’une action en paiement court à compter de la date d’exigibilité de la créance ».
Par ailleurs, les mécanismes d’interruption et de suspension de la prescription complexifient encore la situation. L’article 2240 du Code civil prévoit que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Une simple lettre, un courriel ou même un début d’exécution peut constituer cette reconnaissance. La mise en demeure par lettre recommandée n’interrompt pas en elle-même la prescription, contrairement à une idée répandue, sauf dispositions légales spécifiques.
La problématique de la preuve d’une créance ancienne
La difficulté majeure concernant les créances anciennes réside dans l’administration de la preuve. L’article 1353 du Code civil pose le principe selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Cette règle fondamentale du droit des obligations place le fardeau de la preuve sur les épaules du créancier.
Pour une créance ancienne, plusieurs obstacles se dressent face au créancier :
- La déperdition des preuves avec le temps (documents égarés, témoins indisponibles)
- L’obsolescence des supports de preuve (formats informatiques dépassés)
- La contestation de l’authenticité des documents produits
La jurisprudence se montre particulièrement exigeante concernant la preuve des créances anciennes. Dans un arrêt du 12 juillet 2018 (Civ. 2ème, n°17-16.955), la Cour de cassation a rejeté la demande d’un créancier qui ne pouvait produire que des relevés bancaires sans pouvoir justifier l’origine précise de la créance. Les juges ont considéré que « la production de relevés bancaires faisant apparaître des virements, sans autre élément probatoire, ne suffit pas à établir l’existence et le montant d’une créance ».
Le degré de preuve exigé varie selon la nature de l’acte juridique en cause. L’article 1359 du Code civil distingue les actes juridiques dont le montant excède 1500 euros, qui doivent être prouvés par écrit, et ceux n’excédant pas cette somme, pour lesquels la preuve est libre. Cette distinction influe considérablement sur la stratégie probatoire à adopter.
La question de la conservation des preuves devient centrale. Si la loi impose aux commerçants de conserver leurs documents comptables pendant dix ans, aucune obligation générale de conservation n’existe pour les particuliers. Cette asymétrie crée un déséquilibre dans les litiges entre professionnels et consommateurs.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation des preuves produites. La Cour de cassation a rappelé ce principe dans un arrêt du 3 octobre 2019 (Civ. 1ère, n°18-20.430) en précisant que « les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ». Cette latitude laissée aux magistrats peut engendrer des disparités de traitement selon les juridictions.
Face à ces difficultés, certains créanciers tentent de contourner l’obstacle en obtenant une reconnaissance de dette tardive ou en faisant valoir un commencement de preuve par écrit complété par d’autres indices. Ces stratégies connaissent toutefois un succès mitigé devant les tribunaux, qui restent vigilants face aux tentatives de raviver artificiellement des créances prescrites.
Les moyens de défense du débiteur face à une créance ancienne
Le débiteur confronté à une demande de paiement d’une créance ancienne dispose de plusieurs lignes de défense. La première et la plus efficace reste l’exception de prescription. Selon l’article 2219 du Code civil, « la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». Il s’agit d’un moyen de défense que le juge ne peut soulever d’office, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2019 (Civ. 2ème, n°18-19.657).
Le débiteur peut contester l’existence même de la créance en invoquant l’absence de preuve suffisante. Cette stratégie s’avère particulièrement efficace lorsque le créancier ne dispose que de documents incomplets ou d’indices fragmentaires. Dans un arrêt du 14 mars 2018 (Com., n°16-28.302), la Cour de cassation a donné raison à un débiteur qui contestait une créance ancienne dont le créancier ne pouvait produire qu’un tableau récapitulatif sans pièces justificatives.
La contestation de l’exigibilité de la créance constitue une autre piste de défense. Le débiteur peut soutenir que la créance n’est pas encore devenue exigible en raison d’un terme non échu ou d’une condition suspensive non réalisée. Cette argumentation permet parfois de gagner du temps jusqu’à ce que la prescription soit acquise.
L’exception de compensation représente une arme redoutable pour le débiteur qui dispose lui-même d’une créance à l’encontre de son créancier. L’article 1347 du Code civil prévoit que « la compensation s’opère de plein droit par le seul effet de la loi, même à l’insu des débiteurs ». Toutefois, la preuve de cette créance réciproque peut s’avérer tout aussi complexe que celle de la créance principale.
Le débiteur peut invoquer la renonciation tacite du créancier à sa créance. La jurisprudence admet cette possibilité lorsque l’attitude du créancier traduit sans équivoque sa volonté d’abandonner sa créance. Dans un arrêt du 6 juillet 2016 (Civ. 1ère, n°15-17.346), la Cour de cassation a considéré que « l’absence de réclamation pendant une période particulièrement longue, associée à d’autres éléments concordants, peut caractériser une renonciation tacite à la créance ».
Enfin, le débiteur peut soulever l’abus de droit lorsque le créancier réclame soudainement le paiement d’une dette très ancienne après avoir laissé croire au débiteur qu’il n’exigerait pas son règlement. Les tribunaux se montrent réceptifs à cet argument lorsque la demande tardive cause un préjudice disproportionné au débiteur. Dans un arrêt du 9 novembre 2017 (Civ. 2ème, n°16-22.869), la Cour de cassation a sanctionné un créancier qui réclamait le paiement d’une dette quinze ans après sa naissance, alors qu’il avait entretenu des relations d’affaires suivies avec le débiteur sans jamais évoquer cette créance.
La bonne foi comme élément de défense
La bonne foi du débiteur joue un rôle déterminant dans l’appréciation des juges. L’article 1104 du Code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Un débiteur qui peut démontrer qu’il a légitimement cru être libéré de sa dette bénéficiera d’un regard plus favorable des magistrats, particulièrement lorsque la créance est très ancienne et que le créancier n’a manifesté aucune diligence pour en obtenir le paiement.
Les stratégies probatoires du créancier
Face aux obstacles liés à l’ancienneté de sa créance, le créancier doit élaborer une stratégie probatoire rigoureuse. La constitution d’un dossier solide représente la première étape. Ce dossier doit idéalement contenir le document original constatant la créance (contrat, facture, reconnaissance de dette), les preuves de l’exécution des obligations corrélatives, et les éventuelles relances adressées au débiteur.
Lorsque l’écrit original fait défaut, le créancier peut recourir au mécanisme du commencement de preuve par écrit complété par d’autres indices. L’article 1362 du Code civil définit le commencement de preuve par écrit comme « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ». Dans un arrêt du 5 avril 2018 (Civ. 1ère, n°17-16.586), la Cour de cassation a admis qu’un échange de courriels pouvait constituer un commencement de preuve par écrit.
La preuve par témoignage peut compléter utilement un dossier lacunaire, bien que sa force probante soit limitée. L’article 1361 du Code civil autorise cette preuve « en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, pour toute personne ou en raison des usages ». Les attestations doivent être rédigées conformément aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile pour être recevables.
Le recours à l’expertise constitue une option à considérer lorsque la créance présente un caractère technique ou lorsque des documents anciens nécessitent une analyse approfondie. Le juge peut ordonner une expertise judiciaire en vertu de l’article 232 du Code de procédure civile « lorsque la constatation ou l’appréciation d’un fait exige des connaissances techniques ».
La reconnaissance de dette obtenue tardivement représente une solution efficace mais délicate. Si elle permet de créer un nouveau titre de créance et de faire courir un nouveau délai de prescription, elle doit être obtenue sans vice du consentement pour être valable. La jurisprudence sanctionne sévèrement les reconnaissances obtenues par dol ou sous la pression. Dans un arrêt du 15 janvier 2020 (Civ. 1ère, n°18-25.695), la Cour de cassation a annulé une reconnaissance de dette signée sous la contrainte morale.
L’aveu judiciaire du débiteur constitue une preuve irréfragable selon l’article 1383-2 du Code civil. Le créancier avisé cherchera à obtenir cet aveu lors de la procédure, notamment par le biais de conclusions adverses imprécises ou contradictoires. La jurisprudence admet que l’aveu peut porter non seulement sur l’existence de la dette mais aussi sur son montant ou sur l’absence de paiement.
L’utilisation des technologies modernes
Face à des créances anciennes, les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités probatoires. La récupération de données informatiques archivées, l’analyse de métadonnées ou la reconstitution de flux financiers par des experts en forensique numérique peuvent parfois faire resurgir des preuves que l’on croyait perdues. Dans un arrêt du 22 mars 2017 (Com., n°15-14.690), la Cour de cassation a admis la valeur probante d’une analyse d’expert informatique ayant permis de reconstituer des échanges commerciaux anciens à partir de sauvegardes fragmentaires.
L’intervention du juge dans l’appréciation des créances anciennes
Le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond joue un rôle déterminant dans les litiges relatifs aux créances anciennes. L’article 12 du Code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Cette latitude permet au magistrat d’adapter sa décision aux circonstances particulières de chaque affaire.
La question de la charge de la preuve est centrale. Si le principe veut que le créancier prouve sa créance et que le débiteur prouve sa libération, les juges peuvent moduler cette répartition en fonction des circonstances. Dans un arrêt du 17 mai 2018 (Civ. 1ère, n°17-11.569), la Cour de cassation a admis un assouplissement de la charge de la preuve en faveur d’un créancier confronté à la mauvaise foi caractérisée du débiteur qui avait délibérément détruit les preuves du contrat.
Les présomptions judiciaires constituent un outil précieux pour le juge confronté à des créances anciennes difficiles à prouver. L’article 1382 du Code civil lui permet de s’appuyer sur « des indices graves, précis et concordants » pour forger sa conviction. Dans un arrêt du 7 février 2019 (Civ. 2ème, n°17-31.206), la Cour de cassation a validé le raisonnement de juges qui avaient déduit l’existence d’une créance d’un faisceau d’indices, aucun n’étant suffisant pris isolément.
L’équité joue parfois un rôle dans l’appréciation judiciaire des créances anciennes. Bien que le juge doive appliquer strictement la règle de droit, la jurisprudence montre qu’il peut tenir compte de considérations d’équité dans l’interprétation des faits et l’évaluation des preuves. Dans un arrêt du 4 décembre 2019 (Civ. 3ème, n°18-23.764), la Cour de cassation a approuvé des juges du fond qui avaient rejeté une demande relative à une créance très ancienne dont la preuve était fragile, en soulignant que son admission aurait créé une situation manifestement inéquitable pour le débiteur.
Les mesures d’instruction ordonnées par le juge peuvent s’avérer déterminantes. L’article 10 du Code civil lui confère le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. La comparution personnelle des parties, prévue par l’article 184 du Code de procédure civile, permet au juge d’interroger directement les protagonistes sur les circonstances entourant la naissance et l’évolution de la créance litigieuse.
La question de l’authenticité des documents anciens donne lieu à un contentieux spécifique. L’article 287 du Code de procédure civile organise la procédure de vérification d’écriture lorsque l’authenticité d’un document est contestée. Dans un arrêt du 21 juin 2018 (Civ. 2ème, n°17-15.300), la Cour de cassation a précisé que « la charge de la preuve de l’authenticité d’un document privé incombe à celui qui s’en prévaut lorsque cette authenticité est contestée ».
L’influence de la jurisprudence européenne
La Cour européenne des droits de l’homme a développé une jurisprudence qui influence l’approche des tribunaux français. Dans l’arrêt Zolotas c. Grèce du 29 janvier 2013 (n°66610/09), la Cour a considéré que l’application stricte des règles de prescription aux créances anciennes pouvait, dans certaines circonstances, porter atteinte au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention. Cette jurisprudence incite les juges nationaux à une approche plus nuancée, tenant compte des spécificités de chaque situation.
Perspectives pratiques et recommandations stratégiques
La gestion préventive des risques liés à l’ancienneté des créances requiert une approche proactive. Pour les créanciers, la mise en place d’un système rigoureux de suivi et de relance constitue la première ligne de défense contre la prescription et la déperdition des preuves. La numérisation et l’archivage sécurisé des documents contractuels, des factures et des correspondances permettent de conserver durablement les preuves de la créance.
Les actes interruptifs de prescription doivent être utilisés stratégiquement pour maintenir la créance en vie. Au-delà de l’action en justice, qui reste l’acte interruptif par excellence, le créancier peut recourir à la sommation interpellative délivrée par huissier ou à la reconnaissance de dette régulièrement renouvelée. Dans un arrêt du 13 novembre 2019 (Civ. 1ère, n°18-21.464), la Cour de cassation a rappelé que « la reconnaissance, même implicite, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Pour les débiteurs, la conservation des preuves de paiement pendant une durée excédant largement le délai de prescription constitue une précaution élémentaire. L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». En pratique, les quittances, reçus et relevés bancaires doivent être conservés méthodiquement.
La négociation représente souvent la voie la plus efficace pour résoudre les litiges relatifs aux créances anciennes. Un accord transactionnel, encadré par les articles 2044 et suivants du Code civil, permet d’éviter l’aléa judiciaire et de trouver une solution équilibrée. Dans un arrêt du 19 septembre 2018 (Com., n°17-16.335), la Cour de cassation a rappelé que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
Les modes alternatifs de règlement des différends (MARD) offrent des perspectives intéressantes pour les litiges concernant des créances anciennes. La médiation, encadrée par les articles 21 à 21-5 de la loi du 8 février 1995, permet une approche pragmatique tenant compte des intérêts respectifs des parties. La procédure participative, prévue aux articles 2062 à 2068 du Code civil, offre un cadre structuré pour la négociation assistée par avocats.
Les nouvelles technologies transforment la gestion des créances et de leur preuve. La blockchain et les contrats intelligents (smart contracts) permettent de sécuriser les transactions et d’en conserver une trace infalsifiable. L’horodatage électronique, régi par le règlement européen eIDAS n°910/2014, confère une date certaine aux documents numériques. Ces innovations réduisent considérablement le risque de contestation ultérieure quant à l’existence ou à l’ancienneté d’une créance.
Recommandations sectorielles spécifiques
Pour les établissements financiers, la mise en place de procédures spécifiques de conservation des preuves des opérations de crédit s’impose. La Cour de cassation se montre particulièrement exigeante à leur égard, comme l’illustre un arrêt du 28 mars 2018 (Civ. 1ère, n°17-13.805) où elle a sanctionné une banque qui ne pouvait produire le contrat de prêt original mais seulement des extraits de sa comptabilité.
Pour les professionnels libéraux (médecins, avocats, architectes), dont les honoraires sont souvent réglés avec retard, la formalisation systématique des accords d’honoraires et la mise en place d’un suivi régulier des facturations permettent de prévenir les difficultés liées à l’ancienneté des créances. La jurisprudence leur est généralement favorable lorsqu’ils peuvent produire une documentation complète, comme l’a montré un arrêt du 5 juillet 2017 (Civ. 2ème, n°16-17.277).
Pour les entreprises commerciales, l’intégration des questions de preuve et de prescription dans la politique de gestion des risques devient incontournable. La désignation d’un responsable du contentieux chargé de suivre les créances anciennes et de déclencher en temps utile les actions conservatoires nécessaires constitue une bonne pratique. La Commission des clauses abusives a d’ailleurs recommandé dans son avis n°2017-01 que les professionnels mettent en place des procédures transparentes de conservation des preuves des transactions.
Pour les particuliers, la sensibilisation aux enjeux de la conservation des preuves devient cruciale dans un contexte de dématérialisation croissante. Les associations de consommateurs recommandent la mise en place d’un système d’archivage personnel des documents importants, idéalement sous forme numérique avec sauvegarde sécurisée. Le Médiateur de la consommation, institué par l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015, peut intervenir utilement dans les litiges impliquant des créances anciennes entre consommateurs et professionnels.
